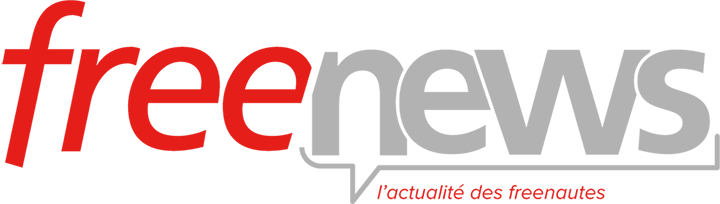Depuis le lancement de son offre TV+ à 2 euros par mois, CANAL+ joue les trouble-fête dans le paysage audiovisuel français selon l’Informé. Cette offre à bas prix, qui regroupe les chaînes de la TNT et du replay, a suscité l’ire de TF1, qui y voit un parasitisme manifeste et une atteinte à ses droits voisins. La Une ne compte pas se laisser faire : elle attaque en justice et réclame 6,5 millions d’euros. Plus qu’un simple différend commercial, cette affaire soulève des questions cruciales sur la régulation, l’accessibilité des contenus, et le contrôle des marques dans un marché en pleine mutation.
L’offre TV+ dans le viseur de TF1.
En 2023, CANAL+ lance TV+, une formule low cost facturée 2 €/mois, incluant les chaînes de la TNT ainsi que du contenu en rattrapage. L’ambition affichée est claire : reconquérir une audience attirée par les plateformes OTT tout en restant conforme au règlement européen sur la portabilité des contenus audiovisuels dans l’UE.
Problème : cette offre serait accessible depuis le Royaume-Uni, en dehors du périmètre légal. Pour TF1, c’est une entorse grave au droit d’auteur, à la propriété intellectuelle et aux droits voisins. Le groupe audiovisuel évoque aussi une confusion autour des marques avec le suffixe « + », que CANAL+ utiliserait à tort pour désigner une plateforme tierce.
TF1 n’en est pas à son premier conflit juridique. Elle avait déjà poursuivi Molotov.tv pour la même raison, obtenant l’interdiction de diffusion de ses chaînes en replay sans contrat.
Les enjeux d’une guerre des plateformes.
Ce bras de fer est assez symptomatique de plusieurs tensions structurelles dans l’univers des médias audiovisuels, et ce pour plusieurs raisons.
CANAL+ adopte une stratégie hybride. En créant TV+, elle tente de rendre la TV linéaire plus attrayante, mais flirte avec les usages et les codes des plateformes OTT. TF1, de son côté, défend un modèle plus vertical et contractuel, fondé sur des exclusivités et des rémunérations directes. L’opposition ne concerne pas seulement les contenus, mais aussi la manière de les distribuer.
Par ailleurs, la diffusion de TV+ au Royaume-Uni est synonyme de pas mal de difficultés relatives à l’application des règlements européens hors de l’Union. Cela pose la question de la territorialité des droits audiovisuels à l’ère du numérique, et des limites pratiques du RGPD ou du règlement sur la portabilité.
Derrière cette querelle juridique se cache une réalité déplaisante pour les consommateurs : les services se fragmentent, les offres deviennent plus opaques, et les accès aux contenus plus contraints. Chaque bataille commerciale entre groupes médias peut se traduire, in fine, par une perte de confort ou une hausse de prix pour les téléspectateurs.
Quelle suite pour ce conflit ?
La justice tranchera sur la notion de parasitisme, sur la validité des droits voisins invoqués, et sur le respect des engagements de CANAL+ vis-à-vis des ayants droit. Mais au-delà du verdict, cette affaire révèle la difficulté de penser une offre audiovisuelle cohérente dans un monde où les usages numériques bousculent les régulations historiques.
Elle soulève aussi une question plus large : comment garantir l’accès universel aux chaînes gratuites de la TNT tout en respectant les règles de droit d’auteur et de propriété intellectuelle ? Et dans ce nouvel écosystème où chaque groupe tente de protéger ses intérêts, qui parle encore au nom du public ?
Le bras de fer entre TF1 et CANAL+ dépasse largement les querelles de marques ou d’audience. Il reflète un déséquilibre grandissant entre innovation technique, contraintes juridiques et attentes des usagers. Dans ce contexte, la construction d’une politique publique audiovisuelle moderne – soucieuse à la fois de souveraineté, de diversité culturelle et de clarté d’accès – devient plus que jamais une urgence.