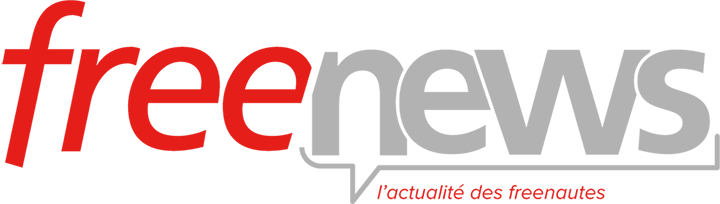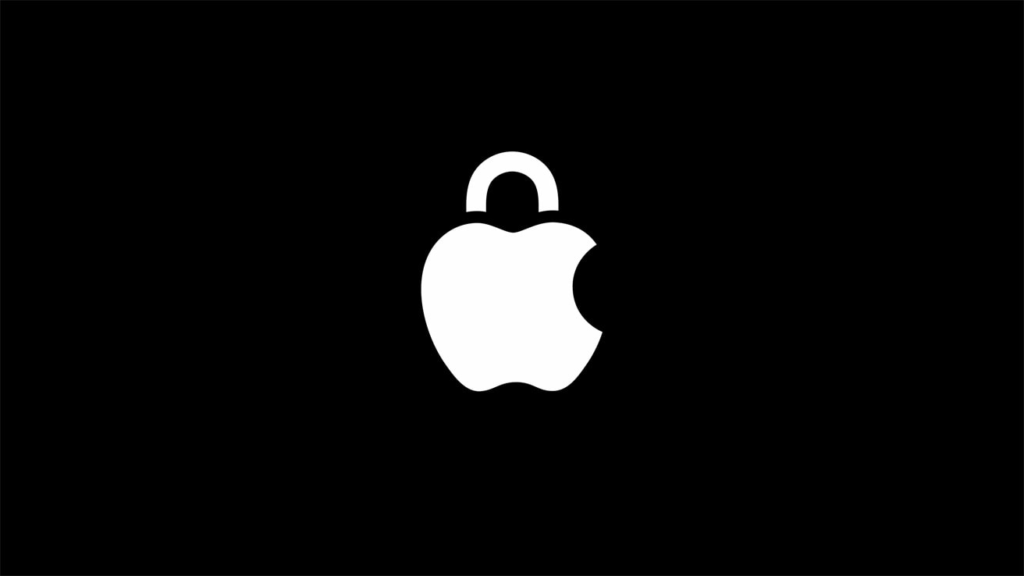Derrière chaque keynote grandiloquente d’Apple, il y a une guerre silencieuse. Une guerre contre la fuite industrielle, les indiscrétions, les rumeurs. Une guerre contre les leakers. Alors que les rumeurs faisaient jusqu’à présent partie du folklore qui accompagne les lancements de produits Apple, la plainte déposée contre Jon Prosser en juillet 2025 marque une inflexion brutale. C’est la première fois qu’un influenceur tech grand public, suivi par plus d’un demi-million d’abonnés, se retrouve traîné devant les tribunaux pour avoir présenté trop tôt une fonctionnalité encore secrète d’iOS 26. Cette affaire surgit dans un contexte bien plus large : celui d’une reprise en main autoritaire des canaux d’information par les grandes plateformes tech.
Une fuite qui dérange Apple.
Depuis janvier 2025, Jon Prosser a partagé sur sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux plusieurs d’éléments liés au futur système iOS 26, dont l’interface épurée baptisée « Liquid Glass ». Ces visuels ont été publiés bien avant leur présentation officielle lors de la WWDC. Dans sa plainte, Apple décrit une chaîne d’obtention frauduleuse : un iPhone de test entre les mains d’un ingénieur, Ethan Lipnik, aurait été dérobé temporairement par un proche, Michael Ramacciotti, qui l’aurait déverrouillé et montré en direct via FaceTime à Jon Prosser.
Selon Apple, Prosser aurait enregistré la vidéo pour ses futures publications, allant jusqu’à offrir une rétribution et une opportunité de collaboration à Ramacciotti. C’est un courriel anonyme qui aurait permis à la firme de Cupertino d’identifier les protagonistes et de remonter le fil de la fuite. Lipnik a depuis été licencié. Jon Prosser, lui, nie toute intention frauduleuse et affirme ne pas avoir eu connaissance de la manière dont les images ont été obtenues.
Mais un signal fort aux écosystèmes de l’info tech.
Apple ne se contente plus de renforcer ses dispositifs de confidentialité internes. Avec cette action en justice, elle tente de faire jurisprudence : définir les frontières de la responsabilité dans la chaîne de l’information pré-commerciale. La cible n’est plus l’employé indiscret, mais l’acteur médiatique influent qui valorise l’exclusivité. Dans une industrie dominée par le buzz, la première image, la première vidéo, la première analyse visuelle, les enjeux sont aussi éditoriaux que financiers.
Le contenu exclusif génère du trafic, des revenus publicitaires et une autorité sociale. Dans cette « économie de l’attente », les entreprises tentent de reprendre la main sur leur narratif. Mais ce faisant, elles ouvrent aussi un débat juridique et moral sur le statut des leakers : doivent-ils être traités comme des journalistes protégés par la liberté de la presse, ou comme des complices de recel d’information confidentielle ?
Une affaire à replacer dans un contexte judiciaire plus large…
L’affaire Jon Prosser rappelle d’autres précédents célèbres impliquant Apple. En 2010, Gizmodo avait récupéré un prototype d’iPhone 4 oublié dans un bar par un employé. Le site avait publié un article détaillé sur l’appareil, provoquant la fureur d’Apple, qui avait alors perquisitionné le domicile d’un journaliste. Si l’affaire n’avait pas abouti à des poursuites pénales, elle avait posé la question du respect de la liberté de la presse face à la protection du secret industriel.
Autre exemple : les enquêtes internes chez Foxconn et Pegatron, sous-traitants d’Apple, ont mené au licenciement d’employés pour avoir révélé des informations sur les chaînes de production. Depuis ces événements, Apple a durci ses politiques internes : restriction des accès, compartimentation de l’information, NDA renforcés. Depuis 2018, les formations à la sécurité de l’information sont obligatoires pour les employés des unités sensibles. Chaque collaborateur en contact avec des prototypes signe des clauses de confidentialité dont la violation entraîne des poursuites immédiates.
… et son évolution juridique à suivre aux États-Unis et ailleurs.
Cette affaire s’inscrit dans un contexte où les autorités américaines durcissent leur cadre juridique en matière de confidentialité technologique. Plusieurs États, comme la Californie et New York, adoptent activement des lois anti-espionnage économique afin de renforcer la protection des secrets d’entreprise. Parallèlement, les instances fédérales mènent des discussions pour encadrer plus strictement le rôle des influenceurs tech dans les stratégies de communication des marques, ainsi que leurs responsabilités vis-à-vis des informations confidentielles qu’ils diffusent.
Même si le journalisme d’investigation bénéficie de la protection du Premier amendement, les influenceurs et créateurs de contenu n’entrent pas dans cette catégorie. Ne relevant pas formellement de la presse, mais publiant des informations accessibles au grand public, ils deviennent des cibles de choix pour les actions judiciaires intentées par les grandes entreprises. En portant plainte contre Jon Prosser, Apple place la justice face à un dilemme : faut-il privilégier le droit à l’information ou protéger les secrets industriels ? Cette affaire pourrait bien créer un précédent.
Une question d’éthique, mais aussi de liberté d’informer.
En effet, au-delà du cas Apple, l’affaire Prosser oblige à s’interroger : où commence une véritable démarche journalistique, et où commence l’influence opportuniste ? Jon Prosser se revendique comme un passionné de technologie, et non comme un acteur du piratage industriel. Il reconnaît avoir diffusé les images, mais réfute toute complicité dans leur obtention. De son côté, Apple cherche à envoyer un message clair : elle ne tolérera plus les fuites, peu importe le canal utilisé pour les relayer.
Ce bras de fer est la parfaite illustration d’une tension croissante : d’un côté, le public réclame plus de transparence et d’avant-premières, de l’autre, les entreprises exigent plus de contrôle et de confidentialité. La communauté tech, souvent avide de leaks, doit elle aussi se poser une question : en relayant des fuites, cultive-t-elle simplement la curiosité, ou cautionne-t-elle un vol d’information ?
Apple cherche à imposer un nouvel équilibre informationnel. Mais à quel prix ?
Avec cette plainte, l’entreprise redéfinit les limites de ce qu’elle considère comme acceptable en matière de communication non autorisée. Elle affirme sa volonté de contrôler l’ensemble du discours public autour de ses produits. Mais ce choix stratégique soulève une inquiétude légitime : jusqu’où une entreprise peut-elle restreindre la diffusion d’informations qui relèvent, au moins partiellement, de l’intérêt du public ?
En parallèle, les juridictions américaines — tout comme celles d’autres pays — suivent attentivement l’évolution juridique de cette affaire. Ce qu’elles décideront contribuera à redéfinir les droits et les obligations des créateurs de contenu tech, désormais considérés comme des relais majeurs d’information. Cette transformation annonce peut-être une nouvelle ère : plus professionnelle, plus encadrée, mais aussi plus exposée aux risques juridiques.
Entre la tentation du contrôle total et la nécessité de préserver un droit à informer, la route vers un équilibre éthique reste semée d’embûches. Mais elle s’impose comme un chantier urgent.