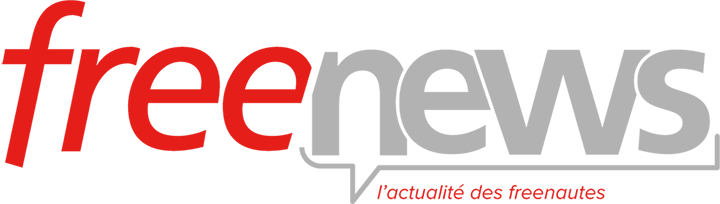Coup d’accélérateur dans la lutte contre le piratage audiovisuel. Le Conseil d’État vient de donner raison à CANAL+ contre l’Arcom, autorité de régulation de l’audiovisuel, sur un point juridique majeur : l’obligation de fournir un certificat de non-appel pour obtenir le blocage de sites pirates miroirs selon Marc Rees pour l’Informé . Cette décision supprime une contrainte administrative lourde et pourrait significativement raccourcir les délais d’action contre le piratage.
CANAL+ conteste une procédure jugée trop lente.
Lorsque CANAL+ ou d’autres ayants droit obtiennent une décision judiciaire pour bloquer un site pirate, celui-ci est souvent rapidement remplacé par un « site miroir » — une copie quasi identique du site initial, avec une adresse différente. Pour bloquer ces clones, il faut relancer la procédure ou obtenir une extension du blocage via l’Arcom.
Mais jusqu’à présent, l’Arcom exigeait de CANAL+ un certificat de non-appel pour considérer une décision judiciaire comme définitive. Ce document n’était délivré qu’après un délai de deux mois, et parfois bien plus si d’autres pièces étaient requises. Le résultat ? Une latence de 2 à 5 mois avant de pouvoir faire tomber les nouveaux sites pirates.
Une décision qui clarifie cependant et allège la procédure.
Dans sa décision rendue en juillet 2025, le Conseil d’État a jugé que cette exigence était contraire au droit. En droit administratif, une décision judiciaire est exécutoire immédiatement, sauf si un recours est effectivement introduit. L’Arcom ne pouvait donc pas imposer une attestation de non-appel comme condition préalable.
Conséquence directe : CANAL+ n’a plus à attendre que la justice confirme l’absence d’appel. Elle peut demander directement le blocage des sites miroirs, ce qui permet une action quasi-immédiate une fois la première décision rendue. Pour les opérateurs de réseaux, cela signifie des consignes plus rapides à appliquer.
… et qui fait jurisprudence ?
Au-delà du cas CANAL+, cette décision pourrait bousculer la manière dont l’Arcom encadre les mesures de lutte contre le piratage. En supprimant une exigence formaliste, le Conseil d’État met l’accent sur l’efficacité du droit face à l’urgence numérique. Dans un contexte où les plateformes pirates se reproduisent à grande vitesse, cette simplification apparaît comme une nécessité opérationnelle.
D’autres ayants droit (Ligue de Football Professionnel, studios de cinéma, majors de la musique) pourraient invoquer cette jurisprudence pour demander une révision des pratiques de l’Arcom. De même, les fournisseurs d’accès à Internet devront adapter leurs systèmes de blocage à une cadence plus soutenue.
Quelles limites et quelles suites ?
Cette victoire juridique ne règle pas tout. Les sites miroirs apparaissent parfois via des adresses IP dynamiques, des extensions exotiques ou des réseaux anonymisés (VPN, proxy, Tor…). Il faudra donc combiner cette accélération procédurale à des outils plus techniques : fingerprinting, IA de reconnaissance de contenu, coopération avec les DNS, voire blocage à la source chez les hébergeurs.
Mais cette décision donne un signal clair : la régulation ne peut plus attendre. L’efficacité de la lutte anti-piratage passe aussi par l’élimination des lourdeurs administratives qui profitent aux fraudeurs.