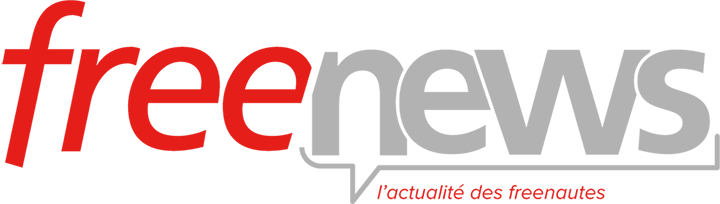C’est un vote bipartisan presque unanime : le Sénat américain vient d’invalider le moratoire de 10 ans sur la régulation de l’intelligence artificielle prévu dans le mégabill fiscal de Donald Trump. Un amendement porté par la sénatrice républicaine Marsha Blackburn, soutenu par 99 sénateurs contre un seul, relance la capacité des États américains à légiférer sur certains usages de l’IA. Cette décision marque un revirement majeur dans un contexte où la technologie façonne à grande vitesse la société et le droit.
Fin du bouclier fédéral, retour aux législations locales.
Le 1er juillet 2025, lors d’un marathon législatif surnommé « vote-a-rama », le Sénat américain a adopté un amendement crucial. Proposé par la sénatrice Marsha Blackburn (Républicaine – Tennessee), il supprime une disposition du projet de loi de Donald Trump qui instaurait une interdiction de dix ans empêchant les États fédérés de réguler localement l’intelligence artificielle.
Initialement, un compromis avait été envisagé avec le sénateur Ted Cruz : réduire le moratoire à cinq ans et tolérer certaines exceptions, comme la sécurité des enfants en ligne ou la protection de la voix des artistes. Mais Blackburn a jugé ce texte insuffisant et a préféré revenir à une position plus radicale, en supprimant purement et simplement l’interdiction.
Le vote final : 99 voix pour, 1 contre. Le seul sénateur à s’opposer fut Thom Tillis (Républicain – Caroline du Nord).
💡 Décryptage : les États-Unis entre innovation débridée et protection locale
L’intelligence artificielle, perçue comme un moteur de croissance économique, divise profondément les acteurs politiques américains. Alors que des géants comme Google ou OpenAI militent pour une régulation fédérale unique (donc plus prévisible et favorable à l’innovation), plusieurs États souhaitent pouvoir fixer leurs propres règles, notamment sur les sujets sociétaux sensibles :
- reconnaissance vocale et deepfakes,
- respect de la vie privée,
- sécurité des enfants en ligne,
- régulation des usages artistiques ou médiatiques de l’IA.
Avec cette décision, la souveraineté réglementaire revient aux États. Le Tennessee, par exemple, a déjà adopté la loi ELVIS pour protéger la voix et l’image des artistes face à l’IA. Le Texas, lui, légifère sur les contenus pédopornographiques générés par IA. La nouvelle donne législative pourrait renforcer cette dynamique décentralisée.
Un revers pour Trump et la Silicon Valley ?
Le mégabill Trump, qui inclut des réductions d’impôts massives et un fonds de 500 millions de dollars dédié à l’IA, visait à harmoniser le cadre réglementaire pour éviter une fragmentation juridique. La levée du moratoire complexifie ce dessein. Elle crée désormais un risque de patchwork législatif, dans lequel chaque État impose ses règles… ou ses restrictions.
Les grandes entreprises de l’IA redoutent cette complexité. Selon elles, elle freinerait l’innovation, nuirait à la compétitivité et créerait un climat d’incertitude juridique.
Une victoire des législations locales dans une Amérique fracturée.
Avec ce vote historique, le Congrès américain ouvre la voie à une nouvelle ère : celle d’une régulation fragmentée, mais adaptée aux réalités locales. À court terme, cela pourrait protéger plus efficacement les citoyens. À long terme, cela pose un défi majeur à l’industrie de l’IA qui espérait un cadre stable à l’échelle fédérale.
La bataille de l’IA aux États-Unis ne fait que commencer. Et elle pourrait inspirer d’autres démocraties à revaloriser leurs propres mécanismes de souveraineté numérique.